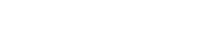XI ème siècle
Époque des RICHONIM (Rif, Rambam et Roch) et des TOSSAFISTES
Par Isaac Sebbag
1013/1103, le RIF (Richon)
Né près de Constantine en Algérie en 1013, mort à Lucena (Espagne) en 1103 fils de Yaâqov ha-Kohèn; l’un des plus importants décisionnaires de la deuxième génération après les Guéonim de Babèl.Il étudie à Kairouan (Tunisie), puis il vit à Fès (Maroc) où il demeure jusqu’en 1088, d’où son surnom, Alfasi, et son acronyme, RIF, initiales de Rabbi Isaac Fasi). En 1088, quittant Fès après 40 années de service à cause de la dénonciation d’un riche notable de Fès, il est accueilli en Espagne et remplace, à la tête de la prestigieuse académie talmudique de Lucéna, R’ Yitshaq Ibn Guiyat qui venait de décéder et laisse ensuite sa place à son élève R’ Yaâqov Migache. Son ouvrage consiste en une compilation des lois juridiques de la Guémara, une collection de 320 responsa, et son magnifique ouvrage Sefer HaHalacha, version abrégée du Talmud.. Parmi les disciples du Rif se trouvent, son fils R’ Yaâqov, R’ Baroukh Élbilia, R’ Yéhouda ha-Léwi.
Une grande aide peut être trouvée dans le recueil du Rabbénou Yits’haq Alfassi (1013-1103), dit le Rif, qui a étudié auprès de R. ‘Hananel et de Rabbénou Nissim à Kairouan, puis a vécu à Cordoue.
Son livre principal, inséré dans les éditions les plus complètes de la guémara, est intitulé Hilkhote Rav Alfas ; il ne garde des passages de la guémara que ce qui concerne les conclusions halakhiques.
Le Rambam estime qu’il n’est pas possible, hormis quelques cas, de diverger de ses analyses. C’est un livre de base dans la formation.
Il est lui-même commenté, au 12e siècle, par les Hassagote du Ravad III, par le Baâl Hammaor ou Rabbénou Zarakhia Hallévi, Rabbénou Yéhonatane de Lunel ; au 13e siècle, par le Rambane dans Mil’hamote Hachém et Séfér Hazzékhoute, et par Rabbénou Yona de Gérondi ; au 14e siècle, par Rabbénou Nissim de Gérondi ; au 15e siècle, par Rabbénou Yossef ‘Haviva dans Nimouqéï Yossef, etc.
Le ‘Haféts ‘Hayim dit de son livre : « J’ai résolu de donner un bon conseil sur la manière d’acquérir une large connaissance de la Torah : que l’on apprenne les bases du talmud, c’est-à-dire que l’on étudie le condensé qu’en a fait le Rif, Rabbi Yits’haq Alfassi, avec le commentaire de Rachi… Ce conseil est donné par le Gaone de Vilna… Utilisant cette méthode, on pourra acquérir une connaissance large de l’ensemble de la Torah… ». Tout cela pour insister sur l’importance du Rif. Son commentaire est souvent placé en fin des commentateurs du Talmud ; il se reconnaît par le fait qu’il est disposé typographiquement comme une page de traité du talmud. Il est suivi du commentaire du Mordékhaï (Mordékhaï ben Hillel Haccohén, 1240-1298), qui voulait en être une introduction et le complète en lui ajoutant les conclusions halakhiques des tossafotes de France.
1021/1057, R.Chlomo ben Yehouda ibn Gabirol,auteur de « Keter Mal’hout », « Mekor Hahaim » et « Midot hanéféch »
Né à Malaga en 1021, mort à Valence en 1058, poète et philosophe espagnol, parmi les penseurs les plus originaux du monde juif au Moyen-Âge. Nombre de ses poèmes ont été introduits dans le Rituel des Prières, en particulier le Kéter Malkhout, récité dans certaines communautés le soir du Yom Kippour. Son ouvrage de base est le Mekor Ha-Hayime, manuel de métaphysique pure qui se présente sous la forme d’un dialogue fictif entre un maître et son disciple. Le philosophe espagnol soulève ce problème : Comment D’ieu, pur esprit, a-t-il pu créer le monde matériel? Il répond qu’à l’origine des choses, il y a la volonté divine qui, par essence, est identique à D’ieu, mais qui, sur le plan de l’activité créatrice, s’en distingue. Cet ouvrage, écrit en arabe, a été traduit en latin au douzième siècle et résumé en hébreu moderne et publié en 1926. Ses autres ouvrages comprennent Tikkoun Middot Ha-Nafèche, approche unique sur les vertus et les vices relatifs aux cinq sens, chaque sens devenant l’instrument de deux vertus et de deux vices.
1040/1105, Rachi
Rabbenou Shlomo Yitzhaki, dit le Parshandata, est un rabbin champenois né en 1040, et décédé en 1105. Il passa la plus grande partie de sa vie à Troyes, mais alla étudier dans les académies de Worms, Spire et Mayence.
La lignée de Rachi remonterait à R’ Yohanan Hassandelar et au roi David; il est le chef et le modèle de l’École française qui fleurit du 10ème au 14ème siècle. Sa clarté et sa concision sont incomparables.
Rachi a rédigé un commentaire sur la Bible hébraïque, et pratiquement tout le Talmud, achevé par son gendre et ses petits-fils.
Le commentaire de Rachi a ouvert à tous ce qui, autrement, serait resté un livre hermétique. Sans son commentaire, personne n’aurait pu naviguer sur la Mer du Talmud. Chaque mot est précis et chargé d’une signification intérieure. Les corrections de Rachi sur le texte du Talmud ont été, pour la majorité d’entre elles, incluses dans les éditions courantes, et c’est ce texte qui fait autorité. Le commentaire de la Bible de Rachi a eu un impact similaire et, en fait, presque toutes les Bibles hébraïques imprimées contiennent ce texte qui se distingue par sa sobriété, sa clarté et sa fidélité à la lettre de l’Écriture. Les études bibliques et talmudiques traditionnelles n’omettent jamais l’explication de Rachi, base de toute exégèse. Humble il n’accepte aucune position rabbinique et continue à exercer son métier de marchand de vins.
Il n’hésite pas à recourir à la langue d’oïl (la langue vernaculaire de la France du Nord du XIe siècle) afin de simplifier encore plus l’explication proposée.
Il est inexact de dire que Rachi a été seulement un parchane et non un posséq car il a laissé de nombreux réponses et décisions halakhiques.
1050/1120, Bahya Ibn Peqouda, auteur de « Hovot haLévavot »
Né à Sarragosse zn 1050 et mort en 1120, fils de Yossèf, Rabbènou Bahiya, moraliste et auteur de Hovot ha-lévavot, , Les Devoirs du Coeur, ouvrage subdivisé en dix sections appellées, Portes, dans lequel il invite le fidèle à retrouver le pur amour de D’ieu par la pratique d’une certaine ascèse et par la soumission à une discipline de tous les instants. Il y donne, pour la première fois, une théorie complète et systématique de la morale juive. Il exerce la fonction de Juge Rabbinique à Saragosse. Pour lui la droiture, l’humilité et la simplicité sont les conditions essentielles de l’accomplissement des préceptes divins.
Son livre a été traduit de l’arabe en hébreu par Yehouda ibn Tibon en 1161 puis par Y.Kimhi
1055/1135, R.Moché ben Yaacov ibn Ezra, auteur de « Arougat Habossem »
et de slihots sépharades, poète, philosophe et linguiste né à Grenade
1060/1135 : R.Meir ben Chmouel de Ramerupt
gendre et élève de Rachi, un des premiers tossafistes, père de Rachbam, Rivam et Rabbénou Tam
?/1105, R.Simha ben Chmouel, auteur du « Mahzor de Vitry »
-.Simha ben Chmouel de Vitry, père de R.Chmouel, le gendre de Rachi
– Un des plus anciens livres de prière. du 11e siècle rédigé par Rabbi Sim’ha ben Samuel. de Vitry. élève de Rachi. C’est un livre très important pour l’étude de l’évolution des prières.
1077/1141, R. Yosse Ibn Migache, le « Ri Migache »
né à Seville en 1077, mort en Espagne en 1141
fils de Méir ha-Léwi, talmudiste et enseignant, il étudie avec le Rif durant 14 années. Ce dernier, bien que son fils Yaâqov soit un sage éminent, désigne Ri Migache comme son successeur. À la tête de la renommée académie de Lucéna, Ri Migache enseigne à de nombreux élèves dont R’ Maimon, père du Rambam. Ayant assimilé l’enseignement de R’ Yossèf reçu de son père, R’ Maimon, Rambam le cite comme mon Maître alors qu’il avait six ans lors du décès de Ri Migache. Il rédige Chéélot ou Téchouvot HaRi Migash, responsa, ainsi que de nombreux commentaires sur le Talmud, dont Baba Batra et Shvouot.
1080/1171, le Rachbam
né à Ramerupt en 1085, mort en France en 1174
TOSSAFISTE. fils de R’ Mèir bèn Chémouèl, petit fils aîné de Rachi par sa mère, Yokhéved, et qui, de son village de Ramerupt (Champagne), exerce une grande influence sur le judaïsme français de l’époque.
Il était le frère du grand Rabbénou Tam. Très marqué par l’autorité de son grand-père, il passe beaucoup de temps avec lui à débattre de sujets d’ordre légal et exégétique et il lui servit de secrétaire. En matière d’exégèse, il est rapporté de nombreux exemples où Rachi accepte l’opinion de son petit-fils. Il complète l’oeuvre de son grand-père en terminant les commentaires talmudiques qu’il avait laissés inachevés et en composant un nouveau commentaire sur la Bible; il commente le Traité Baba Batra, , et le dernier chapitre de Péssahim, , que l’on retrouve dans les éditions du Talmud. Il est le premier de l’Ecole française à utiliser la méthodologie du Rif.
1085/1145, R.Yehouda ben Chmouel Halévi, auteur du « Kouzari »
né à Tolède en 1085, mort en Érèts Yisraèl en 1145, disciple du RIF
un des plus grands poètes et penseurs d’Israël, connu aussi par les Arabes sous le nom de Abou El Hassan El Levi, il est influencé par la double culture juive et arabe. Ses poèmes sont parmi les plus beaux qui aient été écrits par un poète juif, et plusieurs ont été introduits dans la liturgie. Les Sionides, chants dans lesquels le poète exalte sa nostalgie de la Terre Sainte, sont restées très célèbres. Le Livre du Kouzari, , qui a pour cadre l’histoire de la conversion au judaïsme du roi des Khazars (ancienne peuplade vivant au Sud de la Russie), présente le dialogue de ce roi tour à tour avec un philosophe, un savant chrétien, un sage de l’Islam et avec un rabbin. Le dialogue avec le rabbin constitue l’essentiel du livre. Yéhouda Ha-Léwi critique les tendances trop rationalistes du judaïsme espagnol; il insiste sur l’élection d’Israël, due à son intimité avec Dieu, sur le caractère particulier de la Terre Sainte, et oppose enfin le D’ieu d’Israël au Dieu des philosophes.
1090/1130, le Rivam
R.Ytshak ben Méir, le RIVAM, tossafiste, frère de Rachbam et Rabbénou Tam;
1089/1164, bn Ezra, auteur du commentaire « ibn Ezra », etc?
Né en 1089 à Tolède, en Saragosse, décédé en vers 1164 à Calahorra,fils de Méir, rabbin, poète, philosophe, mathématicien, astronome, grammairien et exégète, une des figures les plus remarquables du judaïsme espagnol et le plus sagace des commentateurs de la Bible, qu’il interprète selon la grammaire et la linguistique sans tenir compte de la littérature homélitique. Il excelle dans tous les genres, en philosophie comme en poésie, mais c’est son commentaire sur la Bible qui est surtout célèbre par son style brillant, ses remarques profondes et même critiques. Sa poésie est teintée d’amertume et de poésie. Au cours de sa vie mouvementée, qui le mène de son Espagne natale en Italie, en France, en Angleterre et en Terre Sainte, il compose de nombreux poèmes didactiques et des traités d’astronomie, de mathématiques, de linguistique et de théologie, il vit au début de sa vie à Cordoue, mais décide de quitter l’Espagne pour Rome. Initiateur des études grammaticales de l’hébreu en Italie, il part pour Lucques, après un assez long séjour à Rome. Là-bas, il se concentre à l’étude de l’astronomie et de l’astrologie. Il est l’auteur de Sèfèr ha-Yachar, , des commentaires sur le Pentateuque, les livres des Psaumes, Job et Danièl; , Sèfèr ha-Yéssod; , Séfat Yètèr; , Sèfèr Ha-Chèm; , Yéssod Mispar, des ouvrages sur la grammaire hébraïque; , Sèfèr ha Ehad; Louhot, , sur l’astronomie et les mathématiques; Kéli Ha-Néhochète, , sur l’astrolabe… et de la zmira « ki echmera Chabat »
Son commentaire biblique est principalement basé sur l’examen minutieux de la grammaire et la philologie hébraïques, ainsi que sur les réalités de la vie à l’époque biblique. Il émet plusieurs théories sur les différents sens que peut revêtir un terme (non exclusifs les uns des autres), avec la question sous-jacente de savoir dans quelle mesure il est possible de s’éloigner du sens littéral. A ses yeux, seules les expessions contenant des anthropomorphismes pour décrire le divin sont à prendre au sens second.
Comme Maïmonide après lui, Ibn Ezra s’exprime rarement de façon claire, semblant réserver son commentaire à une certaine élite. Son style est laconique à l’extrême, au point d’en devenir énigmatique, nécessitant des supercommentaires dont le plus répandu est celui de Rabbenou Shlomo haCohen, intitulé Avi Ezer.
Se faisant défenseur du judaïsme rabbanite contre la dissidence karaïte, il s’appuie également fortement sur les enseignements de Saadia Gaon, dont l’?uvre est toute entière vouée à cette lutte.
Dans l’introduction aux deux versions de son commentaire biblique, Abraham ibn Ezra retrace l’histoire de l’exégèse biblique, du Talmud jusqu’à nos jours. A deux reprises, il distingue quatre méthodes d’exégèes, plus la sienne propre
La première est celle des Guéonim, directeurs des académies talmudiques de Babylone. Ibn Ezra, comparant la vérité au centre d’un cercle, les situe loin du centre, mais dans le cercle. Leurs exégèses contiennent des « digressions inutiles ».
La seconde porte sur les Karaïtes : « ils pensent être au sens du cercle, mais en ignorent en réalité l’emplacement ». Ils fournissent des interprétations contredisant la tradition, dû à leur méconnaissance de la philologie, mais aussi de la grammaire, ainsi que leur remise en cause du calendrier hébraïque, dont dépend la bonne pratique du Judaïsme.
La troisième, l’exégèse chrétienne, et allégorique en général (cf. supra), est descendue en flèches : elle découvre partout des mystères, à interpréter allégoriquement, détournant l’Ecriture de son sens premier. Néanmoins,
La quatrième est celle des Tannaïm et Amoraïm : elle ne souscrit pas aux règles de la philologie, mais contient de profonds secrets qu’il est impratif d’étudier.
Ayant exposé ces quatre formes, ibn Ezra fait part de la sienne : elle est basée sur une bonne connaissance de l’Hébreu En effet, l’Hébreu est le lashon haqodesh, la langue sainte, remontant au premier homme