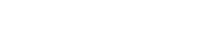Le célèbre juriste Jacques Kohn Zal fut très proche du rav Élie Munk. Il nous livre son témoignage au travers d'une belle anecdote à propos d'un Erouv qui aurait existé, il y a de cela bien longtemps, autour de Paris
« Les relations que ma famille a entretenues avec celle du rabbin Munk ont toujours été très étroites, et elles remontent aux années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. »
Les parents du petit Élie Munk habitaient alors à Paris et ils fréquentaient la synagogue de la Communauté israélite de stricte observance (C.I.S.O), rue Cadet. Étant cependant de nationalité allemande, ils ont dû quitter la France en 1914.
En 1925, Élie reçut son diplôme de rabbin au Rabbiner-Seminar für das orthodoxe Judentum fondé à Berlin par le rabbin Ezriel Hildesheimer, et il devint l’année suivante docteur en philosophie, après avoir soutenu une thèse sur « La philosophie dans les œuvres de Victor Hugo ».
Pendant une dizaine d’années, de 1927 à 1937, il exerça les fonctions de rabbin à Ansbach (Bavière), où trois enfants vinrent égayer son foyer.
À la mort du rabbin Weiskoff, survenue à un âge quasi centenaire, la C.I.S.O. se mit à la recherche d’un successeur. Le rabbin Munk, qui s’inquiétait de la montée du nazisme en Allemagne, posa sa candidature, et c’est à l’occasion de celle-ci que l’on a pu mesurer son courage et la force de son caractère.
Il avait existé jadis un érouv à Paris, réalisé grâce à une ceinture de fortifications, construites à proximité de l’actuel Boulevard Périphérique. La ville était ainsi entièrement clôturée, sans solution de continuité, par des constructions établies sur tout son pourtour.
Cette ceinture a cependant été abattue après la Première Guerre mondiale, ce qui aurait dû inciter les Juifs religieux à ne plus rien porter hors de chez eux pendant Chabbat.
Or, il n’en a rien été, et un bon nombre de fidèles de la synagogue de la rue Cadet ont continué nonobstant la fin de cet érouv à transporter des objets dans la rue.
Lorsque les administrateurs de la synagogue annoncèrent au rabbin Munk qu’ils avaient accueilli favorablement sa candidature, celui-ci posa une condition à son acceptation : il exigeait d’eux qu’ils respectent désormais scrupuleusement l’interdiction de porter pendant Chabbat dans le domaine public.
La communauté se plia à cette exigence, et le rabbin Munk en devint le chef spirituel jusqu’en 1973, année où il se retira aux États-Unis.
On peut dire que son attitude dans la présentation de sa candidature a été particulièrement courageuse : le nazisme enregistrait depuis quatre ans des progrès foudroyants, et le rabbin Munk aurait couru avec sa famille les plus graves périls s’il n’avait pas été accueilli comme rabbin par cette communauté parisienne.
Par Jacques Kohn Zal