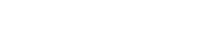Voici les comptes du Michkane, Michkane du témoignage, qui ont été comptés sur ordre de Moché, le travail des Lévites, par l’intermédiaire d’Ithamar, fils d’Aharon le prêtre. (38, 21)
Pourquoi le mot Michkane (« Tabernacle ») est-il répété dans ce verset ? Le terme hébreux peut être lu de deux manières : soit michkane, qui désigne le lieu où réside Hachem, soit machkone, qui signifie « un gage ». La répétition de ce mot, explique Rachi, fait donc allusion à la future destruction des Temples, quand le lieu de résidence de Hachem sera saisi comme « gage » sur les enfants d’Israël qui auront commis des péchés.
Dans le même esprit, Rav ?Hayim Soloveitchik explique le verset de Yecha’ya (1, 27) : « Sion sera rachetée par la justice, et ses captifs, par la charité. » Pourquoi cette différence entre la libération de Sion, qui aura lieu « par la justice », et celle de ses captifs, qui sera obtenue seulement « par la charité » ?
Lorsqu’un créancier opère une remise de dette, fait remarquer Rav Soloveitchik, le débiteur tout autant que son garant sont libérés de leurs obligations. Il existe néanmoins une différence essentielle entre les deux. La décharge dont bénéficie le débiteur est un acte de bienfaisance, étant donné qu’il a, à l’origine, reçu de l’argent du prêteur. Mais celle dont profite le garant, qui n’a jamais recueilli le moindre avantage personnel du prêteur, ne relève aucunement de la charité.
Appliquons cette règle au Michkane : Le lieu de résidence de Hachem, explique Rachi, a servi à garantir la conduite irréprochable des enfants d’Israël. Si l’on peut s’exprimer ainsi, ces derniers étaient les emprunteurs, et le Tabernacle, la caution.
C’est pourquoi, quand Hachem pardonnera aux enfants d’Israël et qu’en conséquence le Temple sera reconstruit, on ne considérera pas sa restitution comme une bonté ou un acte charitable. Ce sera simplement le résultat normal du pardon accordé à Son peuple. Ainsi, la libération de Sion sera un acte de « justice ».
En ce qui concerne les enfants d’Israël eux-mêmes, en revanche, l’acte de pardon sera certainement une bonté, et leur rachat aura donc été opéré « par charité ».
Autre interprétation de ce verset de Yecha’ya par Rav Soloveitchik : Le Temple, explique-t-il, sera reconstruit parce que Hachem a promis de le faire. La justice exigeant qu’Il tienne Sa promesse, nous disons que « Sion sera rachetée par la justice ». Tandis que dans Sa promesse de libérer les captifs ? les Juifs ?, Il n’a jamais désigné une génération particulière ou un groupe précis d’individus comme devant être les bénéficiaires de cette délivrance. C’est pourquoi, quand Il choisira finalement la génération et la catégorie dignes d’être affranchies, ce sera certainement pour elles un acte de « charité ».
Voici les comptes du Michkane. (38, 21)
Pourquoi Moché a-t-il rendu des comptes ? se demande le Midrach Tan?houma (Chemoth 38, 415). Il est certain que Hachem lui faisait entièrement confiance, comme Il l’a déclaré explicitement (Bamidbar 12, 7) : « Mon serviteur Moché n’est pas ainsi, il est fidèle dans toute Ma maison. » Pourquoi alors Moché a-t-il dû se justifier ? C’est parce que les railleurs de l’époque chuchotaient derrière son dos, comme il est écrit (33, 8) : « Ce fut, lorsque Moché sortait [?] ils regardaient derrière Moché. » Et que disaient-ils ? Ils insinuaient : « Un tel homme, à qui incombe la responsabilité des travaux du Michkane, qui gère tant de kikars d’or et d’argent (un kikar, ou ?talent?, correspond à environ 36 kg?), qui les pèse et les compte, ne s’enrichira-t-il pas ? » En entendant ces propos, Moché a annoncé : « Je jure que lorsque le travail du Tabernacle sera terminé, je vous rendrai des comptes ! » Et effectivement, aussitôt la construction achevée, il leur a dit : « Voici les comptes du Michkane? »
Quand le peuple s’est rassemblé pour confectionner le veau d’or, fait observer Rav Zalman Sorotzkin dans son Oznayim la-Tora, aucune allusion n’est faite à quelque exigence d’une reddition de comptes. En revanche, la collecte pour le Michkane a suscité une méfiance latente qui n’a pu être apaisée que par la présentation d’une comptabilité justifiant l’emploi de chaque don recueilli ! Cette tendance est loin d’avoir disparu. Les trésoriers d’organisations charitables sont toujours tenus à une comptabilité minutieuse, tandis que ceux qui recueillent des fonds pour les « veaux d’or » modernes jouissent d’une liberté beaucoup plus grande. Pourquoi en est-il ainsi ?
Cela tient peut-être à ce que chaque Juif, tout au fond de lui-même, souhaite accomplir la volonté de Hachem, en réalisant des mitswoth et en évitant les transgressions. C’est pourquoi, quand il donne de l’argent à une cause charitable, il veille attentivement à ce qu’il soit dépensé correctement, s’assurant ainsi que sa contribution lui procurera le maximum d’avantages. Tandis que, lorsqu’il succombe à son penchant au mal et qu’il dépense de l’argent pour des buts inconvenants, il éprouve un sentiment de culpabilité devant ses transgressions et il n’est pas choqué outre mesure si un peu de ce qu’il a donné est détourné »