Le Rav Boughid ‘Hanania Saadoun z’tsal nous a quitté le 7 ème Jour de Pessa’h, il fut enterré au cimetière de Givat Chaoul à Jérusalem, de nombreux Rabbanim, dont le Rav Ovadia Yossef chalita et le Rav Méir Mazouz chalita, sont venus participer à la Lévaya.
Il fut le Rav de la ville de Djerba pendant près de 20 ans, étant le garant de la Torah et de judaïsme de cette ville, il était agé de 90 ans, durant ses vingt dernières années il dirgea la communauté Djerbienne de France et plus particulièrement de Paris 19ème où il fonda une école de haut niveau en Kodesh ainsi qu’une Yéchiva.
Il a écrit de nombreux livres, dont les profondeurs sont extraordinaires.
Rav ‘Hanina Bouguid Sadoun
Le Grand rabbin de Djerba, puis de la communauté djerbienne à Paris, est décédé durant ‘Hol haMo’èd Pessa’h, alors qu’il se préparait pour l’office du matin. Il avait 90 ans.
Il était l’un des derniers rabbanim de la vieille école djerbienne, ayant été l’élève de rabbi Ra’hamim ‘Haï Havita Kohen zatsal. Il a quitté Djerba voici 17 ans, où il fut remplacé par le rav ‘Hayim Bethan, actuellement le Grand rabbin de la Tunisie. Il s’est installé à Paris, où il a conservé les traditions et la manière d’être de l’île de Djerba dans la communauté de Juifs qui s’est formée autour de lui dans le XIXème arrondissement. Il est à l’origine de la constitution d’un ‘héder et d’une Yéchiva Qetana classiques, sous le nom de «Tora weRa’hamim», où l’on étudie uniquement les matières toraniques, à la différence de la plupart des institutions de ce genre en Europe.
Alors qu’il était le rav de Djerba, il a été convoqué par le maire, qui lui a annoncé que le vieux cimetière juif allait être détruit. Le rav a été très perturbé par cette décision, et a tenté de la faire annuler, en vain. Plus tard, un journaliste américain s’est rendu à Djerba, afin de découvrir la communauté juive locale et sa prestigieuse histoire. Il a été reçu par le rav, qui l’a impressionné par sa sagesse. Avant de partir, il lui a demandé s’il pouvait faire quelque chose pour lui, et le rav lui a raconté la menace qui pesait sur le cimetière, tout en reconnaissant qu’un journaliste ne pouvait rien faire pour l’aider. Mais, de retour aux Etats Unis, ce journaliste s’est rendu chez le président d’alors, Reagan, qu’il connaissait personnellement, et lui a raconté toute l’histoire. Le président Reagan en a été également ému, et a envoyé une lettre à son homologue Bourgiba pour que celui-ci fasse annuler la décision des responsables de l’île, voire accorde au cimetière, où reposaient de nombreuses grandes personnalités juives, le statut de site historique. Ce qui fut fait, et le rav, convoqué à nouveau chez le maire, apprit que le cimetière serait sauvegardé.
Au courant des mois d’été, Tamouz et Av, il se rendait à Bené Braq, et venait étudier à la Yéchiva Kissé Ra’hamim, où une chambre lui était réservée. Il appréciait de parler avec les personnes qui étudiaient à la Yéchiva.
Un jeune issu de la communauté de Djerba vint un jour lui rendre visite. Ce jeune étudiait à la Yéchiva d’Aix-les-Bains. Au cours de la conversation, le jeune lui signala que le rav de la Yéchiva, le rav Chajkyn zatsal., était un élève du ‘Hafets ‘Hayim. Le rav décida qu’il devait se rendre dès que possible à Aix, afin de rencontrer le rav Chajkyn: «Un disciple du Michna Beroura!» ‘ livre de Halakha rédigé par ce rav, que le rav Bouguid respectait énormément. Il fut invité à prendre la parole à la Yéchiva, et, selon le rav Chajkyn, il fut l’une des personnalités qui impressionna le plus le public des élèves.
Voici dix-sept ans, les arabes menaçaient la sécurité du rav, et, craignant qu’il ne lui arrive la même chose qu’au rav Matslia’h Mazouz assassiné par des fanatiques arabes, ses proches l’ont convaincu de quitter la Tunisie. Il s’installa alors à Paris.
Il a laissé derrière un fils, le rav Alter (ce nom lui a été donné après le décès de nombreux enfants en bas âge ‘ ce prénom étant admis, chez les Achkenazes, comme pouvant servir de «Segoula» dans de tels cas), et des petits-enfants.
Il a publié de nombreux ouvrages, dont un commentaire sur la Haggada intitulé Higuid Le’amo, des responsa et des commentaires (Higuid Mordekhaï, Maguid Techouva en plusieurs tomes, ainsi qu’un Rabot Banot ‘ michlé veazharoth Djerba).
Il a été enterré le lendemain de Pessa’h à Jérusalem, aux côtés de son maître, le rav Ra’hamim ‘Hayim ‘Havita Kohen. De nombreux fidèles l’ont accompagné à sa dernière demeure. ( extrait du journal Kountrass )
Détails Calendrier hébraïque
Calendrier hébraïque Bar/Bat Mitsva
Bar/Bat Mitsva Anniversaire
Anniversaire Convertir une date
Convertir une date Yortzeit
Yortzeit Newsletter
Newsletter Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous? Contactez-nous
Contactez-nous
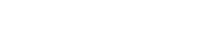


















 Commentaires sur la Parachat Behar : Une confiance absolue. Par le Rav Eliahou Elkaïm de la yéchiva
Commentaires sur la Parachat Behar : Une confiance absolue. Par le Rav Eliahou Elkaïm de la yéchiva 
