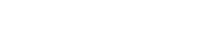Comme nous l’avons évoqué dans le texte « Trois pères – trois prières », l’une des sources de la prière d’arvit apparaît dans notre paracha, lorsque Yaacov « atteint » un lieu et y passe la nuit.
Au sujet de cette prière, une large discussion opposa les maîtres du Talmud, pour déterminer si elle est obligatoire – au même titre que cha’harit et min’ha –, ou si elle n’est que facultative. Deux Sages de la Michna, Rabban Gamliel et Rabbi Yéhochoua s’opposèrent sur cette question, la conclusion de la Guémara étant qu’arvit est une prière facultative.
Si telle est la stricte conclusion halakhique, les décisionnaires démontrèrent cependant qu’au fil des siècles, cette conclusion évolua. Le Rif rapporte tout d’abord que « ceci n’est vrai que pour une personne n’ayant encore jamais prononcé cette prière. Mais si elle l’a déjà fait une fois, ceci constitue une acceptation de cette prière en tant que devoir formel ». Un peu plus loin, le Rif ajoute également : « Mais de nos jours, la coutume du peuple est de considérer cette prière comme étant obligatoire » (Bérakhot p. 19 du Rif). Le Rambam suit une position similaire : « Bien qu’arvit ne soit pas obligatoire au même titre que cha’harit et min’ha, l’ensemble du peuple d’Israël, dans tous les endroits où il s’est installé, a déjà adopté la coutume de réciter cette prière quotidiennement, et l’a acceptée comme un devoir formel » (Téfila 1, 6).
Les Tossefot suivent quant à eux une voie différente, mais qui aboutit à peu près la même conclusion : « La prière d’arvit n’est considérée comme facultative, qu’en comparaison à une autre mitsva, qui ne peut souffrir d’ajournement : dans ce cas précis où ces deux mitsvot surviennent simultanément, nous considérons qu’il est préférable de repousser arvit au profit de l’autre mitsva. Par contre, rien ne permet de renoncer inutilement à arvit. » (Bérakhot 26/a).
L’heure d’arvit
L’heure à partir de laquelle il est possible de prier arvit fait également l’objet d’une discussion talmudique, directement dépendante de l’heure à partir de laquelle on ne peut plus prier min’ha : Rabbi Yéhouda considère que plag hamin’ha (environ 1h15 avant le coucher du soleil) est l’instant où prend fin min’ha et où débute arvit. Les Sages considèrent quant à eux que l’heure de min’ha cesse à la fin du jour – au coucher du soleil – et qu’arvit débute donc à la tombée de la nuit. La Halakha n’a pas clairement tranché entre ces deux avis, le principe retenu étant : « Celui qui agit comme l’un fait bien, celui qui agit comme l’autre fait également bien. » Il est donc possible, en théorie, de prier min’ha jusqu’à la nuit, ou de commencer arvit dès plag hamin’ha. Il existe toutefois une restriction à cette liberté : il faut veiller à ne pas se mettre soi-même dans une situation contradictoire, où l’on se conformerait aux deux avis simultanément. On ne prononcera donc pas min’ha après plag hamin’ha – et suivre en cela l’avis des Sages – pour prier arvit avant la nuit – conformément à l’avis de Rabbi Yéhouda. Il faudra donc adopter l’une ou l’autre de ces opinions, et s’y conformer chaque jour. Les décisionnaires séfarades indiquent cependant que s’agissant des prières publiques, la coutume est de ne plus prendre garde à cette restriction : on pourra selon eux prier min’ha et arvit simultanément, serait-ce même après plag hamin’ha et avant le coucher du soleil.
Prier après la « rédemption »
Pour la prière d’arvit, on retrouve un principe également valable pour cha’harit : il convient de juxtaposer la « rédemption » – la bénédiction de « gaal Israël » – à la prière de la amida. Toutefois, on se montre moins strict à ce sujet pour arvit que pour la prière du matin. De ce fait, si l’on arrive à la synagogue, le soir, alors que l’assemblée s’apprête à débuter la amida, on passera outre ce principe et l’on entamera aussitôt la amida, de sorte à prier avec la communauté. Et seulement après la amida, on reprendra la lecture du chéma et de ses bénédictions (contrairement à cha’harit où l’on n’agira en aucune façon ainsi). Toutefois, l’avis des maîtres de la Cabale est que même pour arvit, on ne modifiera en aucun cas l’ordre de la prière, et l’on récitera toujours le chéma avant la amida, quitte à ne pas prononcer cette prière avec l’assemblée.
La lecture du chéma
Si l’heure de arvit fut, comme nous l’avons vu, l’objet d’un débat, le moment de la lecture du chéma fait quant à lui l’unanimité : par ordre de la Torah, on doit lire le chéma précisément à la nuit. De ce fait, déjà une demi-heure avant ce moment, on s’abstiendra de débuter un repas, d’aller dormir ou d’entamer un travail d’importance, de crainte que ces activités ne se prolongent et que l’on en vienne à oublier d’accomplir cette mitsva. Certains avis autorisent cependant de faire appel à un « gardien ». Ceci consiste à désigner une personne, que l’on charge de nous « garder » et de nous rappeler, après la fin du repas ou du travail, que l’on doit réciter le chéma ou, le cas échéant, également la prière d’arvit. Certains permettent à ce titre de régler un réveil, qui nous rappellera à notre devoir. Dans ce cas, il faudra s’engager à réciter ces prières à l’instant même où le réveil se met à sonner.
L’obligation de réciter le chéma s’achève au petit matin, au moment de alot hacha’har (72 min. avant le lever du soleil). Toutefois, nos Sages interdirent de repousser l’heure de lecture du chéma à après ‘hatsot (le milieu de la nuit), de crainte que l’on oublie ou que l’on soit pris par un empêchement.Par Yonathan Bendennnoune