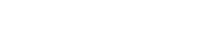La Torah relate dans notre paracha que lorsqu’Essav découvrit comment Yaacov lui avait « usurpé » la bénédiction de son père, « il poussa un cri puissant et douloureux… »
La réaction d’Essav ne manque pas de surprendre. En effet, lorsqu’il accepta de vendre le droit d’aînesse à son frère quelques années plus tôt, il s’était alors exclamé : « Certes, je marche à la mort ! A quoi me sert donc le droit d’aînesse ? » (Béréchit 25, 32). Tout indiquait chez lui que ces valeurs spirituelles l’indifféraient au plus haut point, comme le rappelle Rachi au nom du Midrach : « ‘Certes je marche à la mort’ – Essav demanda à Yaacov : ‘Que signifie ce service sacré [que doivent exécuter les aînés] ?’ Yaacov lui dit : ‘Il renferme des interdictions, des châtiments et parfois même la peine de mort. Il est enseigné à ce titre : Voici ceux qui sont passibles de mort : Les Cohanim qui exercent le service sacerdotal en état d’ivresse, ou en ayant les cheveux longs.’ Essav répondit : ‘S’il en est ainsi, ce service sera la cause de ma mort. Pourquoi le voudrais-je ?’ »
Essav avait donc sciemment renoncé au droit d’aînesse, en ayant bien conscience de ce qu’il impliquait. Il savait que les exigences du service divin étaient extrêmement strictes, et qu’elles allaient à l’encontre de toutes ses passions. C’est pourquoi il choisit de céder ce devoir – et ce privilège – à son jeune frère, qui saurait certainement mieux en tirer profit…
La volte-face d’Essav
Or étonnamment, voici qu’Essav opère une soudaine volte-face. En découvrant que ses bénédictions lui ont été « subtilisées » par Yaacov, il se lamente non seulement de cette perte, mais également de celle du droit d’aînesse : « Est-ce parce qu’on l’a nommé Yaacov, qu’il m’a supplanté [yaakvéni] deux fois déjà ? Il m’a enlevé mon droit d’aînesse, et voici que maintenant, il m’enlève ma bénédiction ! » Pourquoi invoque-t-il soudain le droit d’aînesse qu’il avait jadis si gracieusement cédé à Yaacov ? Et sachant que la bénédiction revenait de droit à l’aîné, pourquoi se lamenta-t-il ainsi du choix qu’il avait fait de plein gré ?
Tiraillements
La réponse est que jamais Essav n’a ignoré le sens et l’implication de ce droit d’aînesse. Il savait très bien que servir D.ieu engage l’homme dans un cercle vertueux de bienfaits spirituels éternels, et qu’à cet égard, le Serviteur mérite toutes les bénédictions. Cependant, comme il l’a lui-même admis, « ce service sera la cause de ma mort » – c’est-à-dire qu’il se considère si dépendant de ses pulsions, qu’il pense être incapable de s’élever à cette dignité. Il reconnaît le bonheur auquel le droit d’aînesse peut le conduire, mais il est incapable de renoncer aux appels de ses désirs. Face à ce puissant dilemme entre l’esprit et le cœur, Essav choisit de renoncer à devenir le serviteur de D.ieu. Il y renonce certes, mais jamais il ne s’en dessaisit totalement : il nourrit toujours l’espoir de « danser dans les deux mondes » – avoir droit au Monde futur, sans ne rien se refuser des bienfaits matériels. Voilà dans quel paradoxe absolu vivait Essav.
Mais la réalité ne tarda pas à le rattraper. Les faits lui démontrèrent qu’on ne peut tout obtenir sans aucune concession. Aspirer au Monde futur exige en effet d’adhérer aux « interdictions, aux châtiments et parfois même à la peine de mort » que cette voie comporte. Et inversement, vouloir jouir de tous les bienfaits matériels suppose un inévitable suicide spirituel.
Cette réalité le frappa de plein fouet le jour où Yaacov lui prit les bénédictions. A ce moment, il réalisa pleinement l’ambiguïté dans laquelle il évoluait, et il comprit que celui qui possède le droit d’aînesse détient aussi forcément les bénédictions. Ce qu’il traduisit comme une supercherie de la part de Yaacov, ne fut en vérité que l’expression de sa frustration la plus profonde. C’est la raison pour laquelle, en apprenant qu’il venait d’avoir été doublé par Yaacov, « Essav poussa un cri puissant et douloureux… et il éleva sa voix et pleura… »
Les pleurs de l’avare
A ce sujet, rav Chalom Schwadron raconta une histoire édifiante au nom de rav Eliyahou Lopian, qui illustre parfaitement ce genre d’attitudes (rapportée dans LéHaguid).
A l’époque où rav Lopian était encore enfant, il vécut à Lomza. En ces temps, l’un des Juifs de Lomza était un avare invétéré, aussi riche que mesquin. Il était si proche de son argent qu’il renonçait même à son propre confort : ses vêtements étaient râpés, usés jusqu’à la corde, et pourtant il ne s’en acheta jamais de nouveaux…
Lorsque sa fille fut en âge de se marier, il lui chercha pour époux « un talmid ‘hakham d’une érudition exceptionnelle ». Il n’épargna pas les efforts, remuant ciel et terre à la recherche de ce gendre talmid ‘hakham. Au cours de ses investigations, il se confia à un ami sur les raisons de son entêtement : « Je sais que les étudiants en yéchiva sont des gens très pauvres. Par conséquent, si mon gendre s’avère être à la fois pauvre, et également un authentique talmid ‘hakham, j’ai l’assurance qu’il ne sera pas trop exigeant aussi bien avant qu’après le mariage : il ne réclamera pas une dot trop importante, et il saura vivre modestement… » Il finit par trouver l’heureux élu, et le mariage fut célébré en toute sobriété.
Les années passèrent et un jour, le gendre fut atteint d’une maladie grave, une occlusion intestinale exigeant d’être traitée dans les plus brefs délais. Face à l’ampleur du mal, les médecins de Lomza s’avouèrent rapidement impuissants. Ils convinrent que le jeune homme devait impérativement être transféré à Vienne. La capitale autrichienne comptait alors parmi les plus grands centres médicaux d’Europe, et l’on y serait à même de l’opérer et de lui apporter les soins requis.
Le point délicat de cette solution était évidemment… son coût. L’étudiant en yéchiva n’avait pas le premier sou pour couvrir les frais du déplacement et de l’intervention. Naturellement, tous les yeux se tournèrent vers le beau-père. Comme son propre gendre n’osa pas le solliciter, plusieurs notables de la communauté se proposèrent d’aller le sensibiliser. Mais le riche homme ne voulut pas en entendre parler : pour lui, l’option d’un voyage à Vienne n’entrait pas en ligne de compte.
Les jours passèrent, le mal continua de ronger la santé du gendre, mais les mains de l’avare restaient toujours aussi fermement agrippées à sa bourse. Finalement, l’illustre rav de la ville – rav Meïr Sim’ha de Dvinsk, auteur du « Or Saméa’h » – décida d’intervenir. Usant de tous les arguments, il s’évertua à fléchir l’avarice du riche beau-père : « Il s’agit pourtant de votre gendre, le père de vos petits-enfants ! Et vous n’ignorez pas que ses jours sont à présent comptés ! » Mais en vain, pas le plus petit sou ne s’échappa de ses poches bien garnies…
La fin de cette histoire fut bien triste : le gendre finit par succomber à la maladie. Toute la communauté juive de Lomza prit part à l’enterrement, et longtemps après, cette procession funèbre continua d’occuper les esprits. Pas tant à cause des circonstances tragiques de cette histoire, mais surtout en raison de la réaction du beau-père : pendant toute la durée de la procession funèbre, il ne cessa de pleurer à chaudes larmes, secoué par des sanglots que rien ne semblait pouvoir apaiser.
Pourquoi toutes ses larmes ? Parce qu’il pleurait non seulement la perte de son gendre, mais aussi cet argent dont il ne parvenait pas à se séparer. Il se savait être la cause du malheur de sa fille, mais il se savait tout autant incapable de renoncer aux sous qu’il avait épargnés pendant de longues années. Son esprit lui disait de céder, mais son cœur l’en empêchait. Alors que fit-il ? Il pleura pendant des heures durant, jusqu’à verser toutes les larmes de son corps. Par Yonathan Bendennnoune, en partenariat avec Hamodia.fr