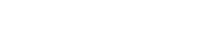La négation de la Shoah est un crime impardonnable. Mais comment agir d’un point de vue juridique contre ceux qui osent émettre des doutes sur cette période tragique de l’histoire du peuple juif ?
C’est pour débattre de cette grave question et donner une définition pratique de la négation et de la « distorsion » de la Shoah que se sont retrouvés, pour des réunions de travail semestrielles, les représentants de 31 Etats faisant partie de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH).
Fondée en 2000, cette organisation, qui compte 31 membres permanents et 10 observateurs, a pour objectif de soutenir et de promouvoir l'enseignement et la mémoire de la Shoah à travers le monde.
Plus de 175 experts du monde entier se sont ainsi réunis à Toronto, le Canada assurant cette année la présidence tournante de l’organisation, après la Belgique. A l’issue de leurs consultations, ils ont tenu une séance plénière au cours de laquelle, parmi les sujets importants qu’ils ont réglés, ils ont donné une définition pratique du négationnisme.
Cette définition, qui a permis de bien cerner le problème, n’a pas force de loi mais elle peut, en revanche, être utile pour lutter contre l’antisémitisme.
Dans le cadre de cette résolution, il a été spécifié entre autres que « la négation de l’holocauste était un discours et une propagande niant la réalité historique et l’ampleur de l’extermination des Juifs par les nazis et leurs complices ». A été dénoncée également « toute tentative visant à affirmer que la Shoah n’a pas eu lieu ».
Il a également été précisé que la négation de l’holocauste sous ses diverses formes était une expression d’antisémitisme. Toutes ces décisions, et d’autres concernant les tentatives de « distorsion de la Shoah », sont déterminantes pour l’avenir étant donné que le négationnisme a pour but notamment de réhabiliter un antisémitisme affirmé qui risque, si on ne l’intercepte pas, d’aboutir à la promotion d’idéologies ou de systèmes politiques de même type.