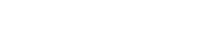II
Religion : pragmatisme ou vérité ?
Section 1.
Il y a deux attitudes fondamentales en ce qui concerne la religion. Je les crois exhaustives et mutuellement exclusives, c’est-à-dire que chaque personne adoptera forcément une et une seule de ces deux attitudes; appelons-les l’approche pragmatique et l’approche réaliste. Dans ce chapitre, je décris ces deux attitudes, et je soutiens la thèse que l’attitude réaliste est la mieux adaptée. Ensuite, il nous faudra examiner comment cette attitude réaliste doit être mise en pratique.
L’approche pragmatique a pour point de départ l’individu : je suis une personne avec des buts, des désirs, des espoirs, des peurs, des projets, des scrupules, etc. Il y a différentes choses que je veux accomplir, et je vois le monde comme un ensemble de ressources à utiliser pour atteindre mes objectifs. Toute l’histoire et la culture humaine peuvent être perçues comme des ressources utiles à l’avancement de mes projets.
Cette attitude, l’approche pragmatique, peut être appliquée entre autres à la religion : la religion peut aussi être utilisée pour servir un but; elle peut unifier la société en coordonnant les activités et en créant une entente mutuelle et une source de soutien; elle peut servir à des fins personnelles en augmentant la sensibilité propre, en procurant une sensation d’unité avec l’Univers, en renforçant le courage, et ainsi de suite. (Parfois ces buts sont combinés : si quelqu’un convainc le reste de ses concitoyens qu’il est un demi-dieu, il en résulte un bénéfice aussi bien politique que personnel !)
L’approche pragmatique de la religion conduit à l’attente que différentes cultures et différentes périodes historiques auront des formes différentes d’expression religieuse, du simple fait que leurs buts, besoins, et valeurs seront considérablement différents – nous nous attendons à ce que les religions de l’Egypte Antique, de la Rome Antique, et du Los Angeles d’aujourd’hui divergent notablement. De la même façon, nous nous attendons à ce que l’expression religieuse d’un individu varie au cours de sa vie : les buts et aspirations sont d’habitude tout autres selon que l’on ait 17, 35 ou 60 ans.
L’expression religieuse pragmatique sera probablement éclectique : il n’y a aucune raison d’être limité par une tradition particulière. Si l’inspiration vient d’une prière hindoue les mardis, d’un rituel musulman les jeudis et du Chabbat juif les samedis, il n’a aucune raison pour ne pas les combiner. En fait, il n’y a aucune raison d’être limité par la tradition en général – la créativité religieuse doit être encouragée pour développer de nouveaux moyens d’expression. Et bien sûr, l’attitude pragmatique inclura l’option zéro, selon laquelle nulle forme d’expression religieuse -quelle qu’elle soit – ne trouve grâce au regard des buts individuels, et en conséquence la religion doit être abandonnée totalement.
Section 2.
La deuxième attitude est celle qui est réaliste : le réaliste veut connaître la vérité. Chaque religion a son histoire à raconter : d’où vient l’Univers ? Quelle est sa nature fondamentale ? Quelles forces guident son développement ? Quelle est la nature de l’être humain ? A quoi ressemblera le futur ? Le réaliste veut choisir la religion dont l’histoire est vraie.
[J’esquive ici un problème difficile: est-ce que pragmatisme et réalisme sont réellement distincts ? On pourrait soutenir la thèse que la connaissance de la vérité est un objectif personnel, et qu’ainsi le pragmatisme, défini comme la recherche des moyens d’atteindre ses objectifs, inclut le réalisme. Mais il n’est pas évident dans cette optique que la recherche de la vérité soit un but en soi . Nous sommes tous à même d’apprécier que la vérité est un moyen indispensable à la poursuite d’autres objectifs, mais peut-être est-ce dans cette vision la seule utilité de la vérité. Sans vouloir trancher cette question, si vous estimez que la vérité peut être un but en soi, il faut alors définir le pragmatisme de manière à exclure la vérité, c’est-à-dire que le pragmatisme comprendra l’évaluation de tout ce qui peut me servir à atteindre mes objectifs autres que l’acquisition de la vérité. De cette façon, les deux positions sont distinctes.]
Une fois la problématique posée de cette manière, il est évident que chacun est à la fois réaliste et pragmatique : tout le monde a des buts, des désirs, des espoirs, des projets, et chacun cherche dans sa culture les ressources pour avancer leur aboutissement; de la même façon, tout le monde est intéressé à connaître la vérité, car elle est un moyen indispensable pour atteindre d’autres buts. Lorsque je dis que ces deux attitudes sont mutuellement exclusives, je me réfère à ce qu’une personne fera lorsqu’elle sera forcée de faire un choix.
Par exemple, supposez que vous exploriez différentes religions, et que vous découvriez celle qui correspond à votre idéal de pragmatique : elle vous inspire, vous anoblit, accroît votre sensibilité personnelle, et contribue à faire avancer les projets auxquels vous êtes intéressé; elle vous va comme un gant. Mais il n’y a aucune indication quelconque que sa description du monde soit correcte; en fait, il y a de nombreux indices à son encontre. Dans un tel cas, vous auriez à choisir entre un pragmatisme satisfait et un réalisme qui ne l’est pas.
Vous pourriez avoir le même dilemme en sens inverse : vous pourriez rencontrer une religion qui serait complètement inadaptée en termes pragmatiques, qui détruirait vos espoirs, violerait vos scrupules, requerrait une réorganisation complète de votre vision du monde, de vos buts et de votre attention; mais il y aurait des indices en faveur de l’exactitude de sa vision du monde. Dans ces conditions, vous auriez à nouveau à faire un choix entre pragmatisme et réalisme, car les deux seraient de toute évidence en conflit. Par conséquent, lorsqu’il faut faire ce type de choix cruciaux, toute personne adopte l’une ou l’autre de ces deux attitudes : le pragmatisme ou le réalisme.
[Bien sûr, il arrive que le réaliste qui accepte la religion sur la base de la vérité ne vive pas en conformité parfaite avec toutes ses règles et valeurs. L’acceptation implique seulement la reconnaissance de la vérité, chacun ayant l’obligation de remplir les exigences de la religion au mieux de ses possibilités.]
Section 3.
Il est bien évident qu’il y a au bas mot des centaines de millions de pragmatiques, et des centaines de millions de réalistes; le monde est rempli de gens des deux types. La question qui se pose est donc la suivante : est-ce que ces deux attitudes sont également appropriées et valides, les gens se répartissant entre les deux en fonction de leurs personnalités et de leurs préférences, ou bien est-ce que l’une des deux est fondamentalement plus appropriée ?
Il me semble que l’attitude fondamentale, par laquelle toute investigation doit être débutée, est celle du réalisme. Tant que la possibilité de l’existence d’une vérité est présente, chacun a la responsabilité de la rechercher . C’est seulement quand on peut conclure à l’inexistence de la vérité qu’il se justifie de prendre les décisions sur la base du pragmatisme.
Je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer pourquoi il en va ainsi. Imaginez que vous êtes un instituteur et que vous avez pris un de vos élèves en train de copier. Vous vous réunissez avec les parents pour une conférence, et vous leur expliquer que leur enfant a un problème : « votre enfant triche à ses examens, copie les devoirs des autres enfants », et ainsi de suite. Supposez que les parents vous traitent de menteur, et vous disent que vous menez une vendetta personnelle contre leur enfant. En plus, ils vous disent qu’ils ont un oncle dans l’administration de l’école, et que si vous continuer à persécuter leur enfant ils vous feront limoger. Pourquoi ne respecterions-nous pas ce type de réactions ? Parce que le comportement de l’enfant est une question de fait ; en toute hypothèse, vous avez la preuve qu’il a triché ! Un parent qui ignore les preuves et ne croit que ce qu’il lui est agréable de croire doit être considéré comme irresponsable et irrationnel.
De la même façon, certaines personnes qui fument m’ont déclaré que la cigarette n’est pas vraiment dangereuse pour la santé. Toutes les recherches sont fausses, payées qu’elles sont par des groupes gauchistes clandestins qui cherchent à discréditer les grandes compagnies commercialisant des cigarettes. En quoi ce type de réponses est-il mauvais ? Le danger pour la santé est une question de fait. S’il existe des indices du danger, la moindre des choses est de les examiner; et s’il y a matière à objection, il faut l’offrir en termes logiques, et pas seulement en rejetant les études sur la base d’une accusation infondée de partialité ou de tromperie.
Nous ne prêtons pas foi aux réponses pragmatiques lorsque des indices pouvant mener à la vérité sont disponibles; toute investigation doit donc commencer par l’attitude réaliste. Quand cette attitude réaliste reste bredouille – l’investigation conduisant à la conclusion qu’aucune vérité ne peut être atteinte – il reste alors bien sûr le moyen du pragmatisme. Mais il n’y a pas d’autre alternative : l’approche réaliste doit avoir la priorité.
Nos considérations ont été jusqu’à présent très générales – elles s’appliquent à toute possibilité de trouver la vérité. Dans le cas de la religion, elles s’appliquent avec une acuité toute particulière. Imaginez un instant que vous vous teniez au Sinaï et que vous entendiez personnellement le Créateur de l’Univers : « n’allumez pas de feux le samedi ! » Pourriez-vous simplement ignorer une telle expérience ? Est-ce qu’elle ne jouerait pas un rôle dans vos décisions pour le week-end ? C’est une expérience qui appelle une réponse ! En outre, une obligation peut exister indépendamment de la question de savoir si vous avez personnellement assisté à l’expérience ou non. Supposez que vous sachiez avec certitude que d’autres ont eu cette expérience : vous sauriez alors que le Créateur ne veut pas de feux le samedi, ce qui est suffisant à créer votre obligation. Ainsi, la vérité religieuse est cruciale pour mener une vie rationnelle et responsable.
Du point de vue de la philosophie, il est vraiment malheureux que la vaste majorité des pragmatiques en matière de religion le soient par défaut. Ils n’ont jamais entrepris d’investigation sérieuse; ils assument tout simplement qu’aucune vérité ne peut être atteinte, et se retournent par conséquent vers ce qui est utile pour leurs projets de vie. Quant à nous, nous allons poursuivre l’attitude réaliste pour voir jusqu’où elle peut nous mener.
[Cette responsabilité de rechercher la vérité n’est bien sûr qu’une obligation parmi beaucoup; elle peut être supplantée quand elle entre en conflit avec une nécessité plus pressante. Par exemple, supposez que rechercher la vérité risque de me coûter la vie ! De plus, il y une discussion considérable quant à la fondation de l’obligation de rechercher la vérité. Ainsi que mentionné dans la dernière section, c’est un moyen particulièrement important d’atteindre nos buts, et c’est peut-être un but en soi. Mais ces questions ne sont que théoriques, et ne sauraient affecter la validité d’ensemble de la démarche. Dans le cas de la religion, l’utilité de posséder la vérité étant éternelle, la responsabilité de la recherche est de toute évidence donnée.]
Section 4.
Une conséquence immédiate de l’approche réaliste de la religion et de la recherche de la vérité est que l’on doit être prêt à rejeter le mensonge. Nul ne peut se mettre en quête de vérité à moins d’être préparé à rejeter les idées inadéquates comme fausses. Quel que soit le sujet à propos duquel nous croyons qu’il existe une vérité, nous savons que dans un ensemble d’opinions contradictoires, si tant est qu’elles soient vraiment contradictoires, une seule est potentiellement correcte.
Nous n’accordons pas le même statut, intellectuellement parlant, aux gens qui ne croient pas en la réalité de l’Holocauste. Nous n’allons probablement pas donner le même poids intellectuel à leurs vues, parce qu’il s’agit là de question de faits, et que les preuves sont contre eux. De la même manière, des groupes comme « The Flat Earth Society » croient jusqu’à aujourd’hui que la Terre est plate. Bien que nous ne les jetterions pas en prison, que nous ne les exilerions pas ni ne les censurerions, nous n’octroierons certainement pas à leur opinion un statut intellectuel équivalent. Nous n’allons sans doute pas leur donner le même temps pour enseigner leurs vues dans les écoles, ou pour écrire leurs manuels à leur idée, parce que ce en quoi ils croient est absurde. Rechercher la vérité implique d’être préparé à rejeter le mensonge.
Quand on en vient aux religions, et je parle maintenant des principales religions du monde, on constate qu’elles se contredisent toutes sur un point crucial de leur foi au moins. En d’autres termes, si vous prenez deux des grandes religions du monde – n’importe lesquelles -, il y aura toujours une proposition à propos de laquelle elles seront en désaccord. Ceci étant le cas, une seule au maximum pourrait être totalement vraie : en effet, si la religion A est 100% correcte, alors chacune des autres a tort au moins pour ce qu’il en est de la proposition à propos de laquelle elle diffère de la religion A.
Par exemple, d’après le Catholicisme, un certain homme fut D.ieu. D’après l’Islam, aucun homme ne fut jamais D.ieu, et aucun homme ne pourra jamais l’être. L’Islam croit que Mahomet a été un vrai prophète tandis que le Catholicisme le dénie. Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux; au moins l’un des deux a tort. L’Hindouisme, dans son courant majoritaire, croit que le monde est infiniment vieux, qu’il n’y a pas eu d’acte de création à aucun point déterminé dans le passé. Puisque le Catholicisme et l’Islam partagent tous deux une croyance en une création et que l’Hindouisme la rejette, cela veut dire qu’au maximum une des trois peut être totalement vraie. Le Bouddhisme va encore plus loin et dénie l’existence d’un Créateur (l’Hindouisme s’accommode d’un Créateur qui a toujours été en train de créer l’Univers depuis l’éternité). Il s’ensuit qu’au plus une des quatre est totalement vraie. Puisque le Judaïsme croit en une création en un point donné, dit que nul homme ne fut D.ieu et que Mahomet n’a pas été un prophète, le Judaïsme s’oppose aux quatre autres. Ceci veut dire qu’une seule de ces cinq religions au mieux peut être complètement vraie.
Et ainsi de suite; prenez n’importe quelle grande religion et elle contredira les autres sur quelque point essentiel de la soi. Ainsi, une seule religion au maximum pourrait être totalement exacte. (Bien sûr, ainsi que vous l’avez déjà compris, il est possible qu’aucune ne soit vraie.) Donc, si nous recherchons la vérité, nous ne pouvons donner un même poids à toutes les religions (sauf à les trouver toutes fausses). Si l’une est juste, les autres ne le sont pas.
Une réponse courante à cette observation consiste à objecter qu’on pourrait peut-être regarder les religions en termes de ce qu’elles partagent. Il y a peut-être un noyau commun à toutes les religions, un sens général de l’existence d’un pouvoir supérieur, une appréciation des aspects moraux et spirituels de notre vie, une conception que le monde matériel n’est pas toute la réalité mais seulement la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être pouvons-nous prendre ce noyau commun à toutes les religions, l’approcher de manière réaliste, en percevoir la vérité, et ensuite considérer tous les autres domaines à propos desquels les religions diffèrent comme de simples questions de style. Les questions propres à chaque peuple ne sont franchement pas cruciales, n’ont pas besoin d’être considérées sous l’angle de la vérité, et peuvent être sélectionnées sur la base du pragmatisme. Nous pourrions avoir une méthodologie double : réaliste dans son essence et pragmatique pour les accessoires. Est-ce vraiment important si vous mangez de la viande le vendredi, fumez des cigarettes le samedi, ou si vous jeûnez toute la journée un mois par an ? Ce ne sont certainement pas là des questions de vérité, seulement de style.
Cette suggestion est attractive jusqu’à ce que l’on commence à en préciser les détails. Qu’est-ce qui doit faire partie de ce noyau (l’ensemble des croyances partagées par toutes les religions) ? Est-ce qu’un récit des origines pourrait y être inclus ? De toute évidence non, les différentes religions ayant des vues radicalement divergentes quant aux origines de l’Univers, ainsi que nous venons de le relever : il aurait été créé par une entité il y a un nombre fini d’années, ou bien il se répéterait en suivant des cycles infinis, ou encore il existerait indépendamment sans la direction d’aucune entité, et ainsi de suite. Il ne saurait pas non plus y avoir de texte sacré dans le noyau, aucun texte n’étant admis par toutes les religions. Pas de prophètes, car aucun n’est universellement reconnu.
Le concept de l’âme ? Certaines religions partagent le mot sans partager le concept, parce qu’il est difficile de traduire d’une langue à l’autre. On peut dire que toutes les religions connaissent « l’âme », mais lorsque vous considérez ce qu’elles pensent être sa nature, vous obtenez des images radicalement différentes; il n’y a aucun point sous-jacent commun à cette multitude.
Est-ce que l’âme est un esprit propre dont la personnalité et l’unicité sont essentielles et infinies – éternelles -, ne pouvant être détruites, comme vous l’avez, par exemple, dans le Judaïsme ? Ou bien la personnalité est-elle une illusion, quelque chose qui doit être arraché pour permettre d’atteindre une conscience qui ne permettrait quant à elle pas de faire de grandes différences entre un homme, un rocher, une mante religieuse ou une mouette, ainsi que c’est le cas dans certaines religions orientales ? Est-ce que la relation ultime avec D.ieu ressemble à une goutte d’eau tombant dans un océan, image que bien des religions utilisent comme métaphore de l’union mystique avec D.ieu, avec une perte totale de l’individualité de la goutte ? Ou bien est-ce la conception juive qui est exacte – celle de l’attachement d’une chose à une autre, comme si on collait un caillou sur un mur, où le caillou devient part du mur tout en préservant dans le même temps ses contours uniques ? Le simple fait que les religions partagent un concept appelé « âme » ne signifie pas qu’elles aient en commun un concept sous-jacent.
A quoi peut-on s’attendre dans le futur ? Est-ce que le monde physique va toujours continuer à exister comme aujourd’hui, comme d’aucuns le prétendent, ou bien sera-t-il radicalement transformé et existera-t-il sous une autre forme, selon la vision juive ? Ou bien encore sera-t-il totalement effacé, en accord avec certaines formes du Christianisme ? Puisque les religions diffèrent à ce sujet, aucun élément ne peut en être repris pour être intégré au noyau.
Dès que vous essayez de préciser les détails des idées religieuses, vous constatez que les différences entre elles sont à ce point radicales qu’il est impossible de prétendre qu’aucun élément soit partagé par toutes les religions. Même la suggestion que toutes les religions ont peut-être un engagement commun en faveur de la moralité pèche par superficialité : toutes les religions vont peut-être admettre qu’il est mal de voler; mais lorsque vous leur demandez le concept derrière la règle, autrement dit pourquoi on ne doit pas voler, vous obtenez des vues radicalement différentes. Par exemple, l’Hindouisme voit majoritairement dans le vol une action qui renforce l’ego; or, l’ego est le plus grand obstacle à l’atteinte du nirvana, le but de chaque personne dans le monde étant d’atteindre ce nirvana, qui est une sorte d’expérience de l’état du moi, une espèce de béatitude. Il s’ensuit que l’Hindouisme prohibe le vol pour des raisons pragmatiques : c’est mauvais pour moi . Je m’empêche d’atteindre le plus grand bonheur, la plus grande félicité, la plus grande tranquillité dont je suis capable. La justification ultime pour l’interdiction du vol est pragmatique.
Lorsque vous prenez la même norme dans une optique juive, vous trouvez que la conception sous-jacente est entièrement différente. D’après le Judaïsme, il est mal de voler parce que la moralité est la valeur suprême. La moralité ne trouve pas sa justification dans le fait qu’elle contribue au bonheur : une raison pragmatique de ne pas voler n’est pas morale du tout. Un individu qui ne vole jamais parce qu’il pense qu’il y a des policiers qui le surveillent en tout temps, qui est persuadé que s’il vole il sera emprisonné, n’a même pas commencé à devenir un être moral. D’un point de vue juif, toute justification de la moralité comme servant l’individu revient à manquer le concept fondamental; le point commun entre les religions est donc en l’espèce une simple règle comportementale, ce qui ne permet pas d’intégrer au noyau une valeur religieuse, quelle qu’elle soit.
Ainsi, l’idée que les religions ont un noyau commun qui pourrait être déclaré vrai, le reste n’étant qu’accessoire, se révèle erronée. Au c?ur même des religions, les concepts les plus fondamentaux s’opposent les uns aux autres. Nous en sommes par conséquent réduits à en revenir à la position radicale, qui est que si nous recherchons la vérité, nous devons être prêts à reconnaître le mensonge quand nous le découvrons.
Section 5.
Ainsi, la question devient maintenant : comment doit-on rechercher la vérité ? Si nous voulons être objectifs et ouverts dans notre quête, ne devons-nous pas accorder un temps égal à tous les candidats ? Ne devrions-nous pas prendre le temps de nous familiariser non seulement avec le Judaïsme, mais aussi avec le Christianisme, l’Islam, le Bouddhisme, l’Hindouisme, le Taoïsme, le Confucianisme, le Shintoïsme (pour ne mentionner que les principales religions du monde) ? Mais il est loin d’être aisé de se familiariser réellement avec la structure interne d’une religion, vous en êtes certainement conscient. Même en prenant 6 mois pour chaque religion, ce qui est probablement trop court, nous parlons d’une investigation de 4 ans; la plupart des gens n’ont tout simplement pas le temps. En fait, j’espère pouvoir démontrer sur la base de considérations générales que l’on peut être objectif et ouvert d’esprit, et pourtant réduire drastiquement le champ de l’investigation.
La méthode la plus adaptée à la quête de vérité est à mon avis la méthode scientifique; avec toutes ses limitations et ses faiblesses, elle est d’ailleurs la seule méthode neutre que nous ayons pour rechercher la vérité. Le problème est qu’elle très mal comprise (y compris par les scientifiques – le simple fait que vous êtes capable de bien faire quelque chose ne signifie pas encore que vous comprenez ce que vous faites ni pourquoi vous le faites). Je vais donc utiliser le reste de ce chapitre pour décrire en détail comment fonctionne la méthode scientifique et pour vous montrer comment elle s’applique à l’étude de la religion. Nous constaterons ainsi que alors que l’utilisation de la méthode scientifique permet de réduire drastiquement le champ d’investigation.
Le point de départ de la méthode scientifique est l’affirmation qu’une idée ne peut être sérieusement considérée comme vraie qu’à la condition sine qua non qu’il existe des indices positifs de sa vérité. Quiconque exprime une idée et prétend qu’elle est fondée doit présenter des éléments de preuve positifs que tel est bien le cas. Si ça vous paraît évident, considérez ce qui suit.
Supposez que quelqu’un croit en une théorie pour laquelle il n’a absolument aucune preuve – l’existence des licornes, par exemple. Son manque de preuves ne le dérange absolument pas : il choisit de croire. Si nous protestons que croire sans preuve est irrationnel, il nous mettra au défi de prouver que les licornes n’existent pas. Pouvons-nous relever ce défi ? Mais comment pourrions-nous prouver que les licornes n’existent pas ? Et si nous en sommes incapables, en quoi est-il plus irrationnel de rejeter l’existence des licornes que de l’accepter ? (Essayez de dire ça à vos amis scientifiques et voyez ce qu’ils vous répondront !)
La réponse est que notre interlocuteur a raison : il n’y a pas plus de raisons de rejeter l’existence des licornes que de l’accepter. Mais il y a une autre alternative : nous pouvons être neutres. sans rejeter ni accepter, sans prendre position pour ou contre. Notre objection aux licornes n’est pas qu’elles n’existent pas, mais simplement qu’on ne doit pas s’engager en l’absence de tout indice positif.
Mais pourquoi pas ? Qu’est-ce mal y a-t-il à choisir de croire quand aucun élément ne s’y oppose ? La réponse est double. Tout d’abord, avoir une croyance a souvent des implications pratiques. Supposez que les licornes soient réputées manger les choux au milieu de la nuit : notre interlocuteur va-t-il alors ériger une barrière ? Ce serait pour le moins un gaspillage de ressources. Dès lors qu’il n’y a aucun indice de l’existence des licornes, rien ne donne à penser que ses choux soient en danger. Plutôt donner l’argent de la barrière à la charité ! La deuxième raison est que la quête de vérité est une responsabilité : croire et agir sur une base pragmatique est irrationnel et irresponsable lorsque la vérité est accessible. Le partisan des licornes choisit de croire sur une base pragmatique : ceci peut être valable pour les licornes – au moins, il n’y a aucun indice dans aucun sens; mais nous traitons de convictions religieuses : avant d’avoir vérifié, nous ne pouvons pas partir de l’idée qu’il n’y a aucun élément de preuve en faveur de la religion en général, ou d’une (ou plusieurs) religion(s) en particulier. Notre but premier est ainsi de trouver des indices positifs de la vérité; nous ne pouvons pas adopter une croyance simplement parce qu’il n’y a aucune preuve contre elle.
Si je suis en quête de vérité, si donc j’essaie de remplir ma responsabilité de trouver cette vérité , il me faut une base de travail sur laquelle effectuer ma sélection; voilà pourquoi l’on ne prête pas attention aux théories sans aucun support. Il est effectivement fondé de ne pas ajouter foi aux idées dénuées de toute preuve, et la raison n’est pas que nous savons que ces théories sont fausses . Pour me répéter, je suis incapable de prouver qu’il n’y a pas de licornes; ce n’est pas la raison qui me fait rejeter cette théorie. La vraie raison est que je n’ai aucun indice positif m’incitant à croire en leur existence. Je peux ainsi ne pas prêter foi à cette idée, sans même chercher à la réfuter, parce que je n’ai pas la responsabilité de l’accepter dès lors qu’elle est sans support.
[Cette position neutre vaut quand nous examinons chaque alternative et les trouvons toutes sans aucun fondement. Mais si nous trouvons qu’une alternative a des indices positifs en sa faveur, cela nous donne une raison de rejeter les autres : elles contredisent celle pour laquelle nous avons une preuve.]
Ceci est le premier aspect de la méthode scientifique et, croyez-le ou pas, cette observation, aussi stupide soit elle, suffit déjà à exclure certains candidats. Les religions d’Extrême-Orient – Confucianisme, Taoïsme, et Shintoïsme – n’offrent aucune preuve de leur bien-fondé. Elles se décrivent comme étant des modes de vie nobles et beaux, qui élèvent l’âme et inspirent, et prétendent créer des attitudes harmonieuses, un sentiment d’unité avec la nature, et ainsi de suite. En d’autres termes, elles se présentent comme très abouties sur un plan pragmatique, ce qui est peut-être bien le cas, mais elles n’offrent aucun indice de la vérité de leurs récits quant à la réalité du monde. Elles ne disent pas : « si vous suivez nos règles, vous serez en bonne santé », « vous n’aurez pas d’accidents », « il n’y aura pas de famines, d’épidémies, de guerres, ou de tremblements de terre dans votre pays », ou « vous obtiendrez le respect de vos semblables ». Elles ne font aucune prédiction d’aucune sorte; elles ne donnent ainsi pas de preuve de leur véracité.
Il s’ensuit qu’une personne réaliste en quête de vérité n’a pas besoin d’aller en Orient et de passer 6 mois à maîtriser le Shintoïsme, parce qu’il n’y a de toute façon aucune raison de l’accepter. Encore une fois, je ne prétends pas que le Shintoïsme est faux; je ne peux pas dire qu’il est faux, puisque je ne peux pas le réfuter! Mais il est à mettre dans le même sac que les licornes… La religion qui ne présente aucune preuve de véracité ne m’impose pas, en tant que personne en quête de vérité, à la considérer sérieusement. Et donc l’investigation a été réduite de 3 huitièmes !
Section 6.
Le deuxième aspect de la méthode scientifique est le suivant : lorsqu’une religion, une théorie ou une hypothèse présente un argument qui joue en sa faveur, cet argument doit pouvoir de la départager des autres. Ce doit être un indice que cette religion, théorie ou hypothèse est seule à même d’expliquer; dans le cas inverse, l’argument ne permet pas de distinguer le candidat de ses compétiteurs. En science, on appelle cela une expérience-clé. Supposez que j’ai deux théories, A et B, telles que toutes deux s’accordent pour prédire qu’en chauffant un liquide donné pendant 10 minutes, ce liquide deviendra rouge. Chauffer le liquide est probablement une perte de temps, parce qu’il va probablement devenir rouge et que je ne saurai rien de plus qu’avant d’avoir fait l’expérience. Ce qu’il faut, c’est un cas où A prédit que le liquide se colorera en rouge et B en bleu. A ce moment-là, quel que soit ce qui se passe, (au moins l’) une des deux théories aura des problèmes. (Et je parle délibérément de problèmes ; un résultat contraire ne veut pas encore dire que la théorie est fausse, mais seulement qu’elle est ébranlée, contredite qu’elle est par une preuve expérimentale.) Ce qu’il nous faut donc, c’est une preuve qu’un des compétiteurs arrive à expliquer et pas les autres, de manière à avoir une différenciation claire entre eux.
Certaines religions donnent des arguments en faveur de leur bien-fondé, mais ceux-ci ne permettent pas de les départager au sens que nous venons de poser; ces aspects ne sont par conséquent pas pertinents pour une personne réaliste qui tenterait d’établir quelle alternative est supérieure. Tel est le cas, par exemple, de l’Islam. Une des deux principales preuves que l’Islam offre de la véracité de sa religion est le succès militaire des partisans de Mahomet. En un siècle, ils conquirent toute l’Afrique du Nord, la Péninsule Arabique, allant jusqu’à l’Inde à l’Est, et pénétrèrent même en Europe. Les musulmans prétendent qu’une conquête aussi rapide aurait été impossible sans l’aide d’Allah.
Comment les non-musulmans perçoivent-ils cet argument ? Un non-musulman demandera : « qu’en est-il d’Alexandre le Grand ? Alexandre a conquis une grande partie du monde avant de mourir à l’âge de 32 ans; il l’a fait beaucoup plus vite que vous. Doit-on dire que les dieux d’Alexandre l’aidaient ? Les Romains régnèrent sur un territoire plus étendu, et le firent pendant 300 ans. Doit-on également dire que les divinités de Rome existaient et aidaient les légions romaines ? » Nous n’avons pas à admettre la véracité de l’Islam pour expliquer leur conquête rapide; un tel phénomène arrive trop souvent pour qu’il n’y ait pas d’autre explication. Une fois que nous savons qu’une conquête rapide peut être expliquée sans en appeler à l’Islam, l’argument cesse de jouer en faveur de ce dernier. Le seules « preuves » uniques à considérer sont celles qu’une théorie est à même d’expliquer alors que les autres en sont incapables .
[L’autre argument avancé en faveur de l’Islam, au cas où vous seriez intéressé, est le suivant : les musulmans prétendent que si vous appreniez l’arabe et lisiez le Coran, vous vous rendriez compte qu’un tel livre ne peut pas avoir été écrit par un être humain; seul D.ieu peut l’avoir écrit. Le problème de cette « preuve » ressemble à celui de la conquête : il est souvent très difficile d’expliquer la créativité humaine; comment Aristote est-il arrivé à créer tellement d’idées, de théories et de disciplines entières nouvelles ? Comment Beethoven a-t-il composé ses symphonies ? Comment Einstein a-t-il pensé à la relativité ? Notre incapacité à répondre à ces question ne prouve pas que l’ensemble est d’origine surnaturelle ! Cela met simplement en lumière notre incompréhension de la manière dont les gens – en particulier les génies – créent.]
Une autre illustration de ce principe – un peu ridicule certes, mais très explicite – est celle de ces groupes qui offrent ce qu’ils appellent une preuve directe de la vérité de leurs croyances religieuses. Ils vous diront : « Nous ne vous demandons pas d’accepter quoi que ce soit par foi aveugle, vous n’avez pas à avoir confiance dans quelque texte ou prophète que ce soit. Venez juste vous joindre à notre secte, asseyez par terre en tailleur, mangez des champignons, dites « om », levez-vous à 2h30 du matin pour prendre des douches froides, et au bout d’un mois vous vous sentirez très différents. En fait, nous allons vous dire comment vous vous sentirez, nous vous le prédisons très précisément. Essayez, nous ne demandons rien pour le logement. Suivez nos règles pendant un mois et voyez si vous ne vous sentez pas exactement comment nous vous le décrivons ».
La personne en quête de vérité se dira : « Eh, c’est formidable : pas de saut de foi; rien d’irrationnel. Etant le sujet de ma propre expérience, j’aurai ainsi directement la preuve que je recherche. Je ressentirai moi-même les effets ». Donc, cet individu se joint à la secte pendant 30 jours, s’assied en tailleur, mange des champignons et prend des douches froides, et ainsi de suite, et en fin de compte il se sent bel et bien différent au bout de 30 jours. En fait, il se sent exactement comme on lui avait prédit. Il en conclut : »voilà, j’ai perçu la vérité par cette expérience personnelle ».
Est-ce une approche valable ? Non, elle n’est absolument pas valable. Que ces gens soient capables de prédire comment l’on se sent après 30 jours de leur régime veut simplement dire qu’ils ont des connaissances pratiques, psychologiques, et rien de plus. Peut-être l’ont-ils eux-mêmes essayé pour en ressentir les effets ? Peut-être ont-ils des lumières réelles sur la psychologie humaine ? En quoi cela conforte-t-il leurs idées religieuses ? Dois-je dénier, en tant que Juif, que si vous vous asseyez en tailleur, dites « om » et prenez des douches froides vous allez vous sentir comme ils le prédisent ? Je n’ai nul besoin de le dénier; je peux l’accepter, tout comme un chrétien le pourrait, ou un musulman, ou un athée. Ce n’est donc pas une preuve à même de départager qui que ce soit, une preuve qu’eux seuls sont à même d’expliquer. Nous pouvons tous l’accepter; elle est ainsi sans aucune incidence. Elle ne nous aide pas à les choisir comme ayant plus probablement raison qu’aucun autre compétiteur, quel qu’il soit, et est ainsi inutile.
L’Hindouisme et le Bouddhisme offrent tous deux des arguments en faveur de leur véracité, mais exprimés en termes d’expérience personnelle seulement. Si vous méditez suffisamment longtemps sur le son d’une main en train d’applaudir, quelque chose se passera en votre esprit; et ce sera effectivement le cas : vous penserez et ressentirez les choses de manière différente. Et alors ? Est-ce que cela veut dire qu’il y a une transmigration des âmes, ou qu’il y a une grande tête de dieu dans le ciel, ou que vous êtes en contact avec une vérité éternelle, ou quoi que ce soit d’autre ? Qu’est-ce que les deux ont en commun ? Ils ont découvert que certains exercices mentaux conduisent à diverses formes d’expériences. Puisqu’en tant que Juif je n’ai pas à dénier l’existence du sartori – peut-être que je ne le trouve pas très utile, mais je n’ai pas à dénier son existence – ou du nirvana, ou de toute autre étape de l’expérience mystique, leurs prétentions et leurs preuves n’ont rien à voir avec la vérité de leur religion. Seule une preuve établie que les autres sont incapables d’expliquer compte comme support pour une idée spécifique .
Section 7.
Et finalement, la preuve offerte doit être connue pour être exacte. Ceci exclut à la fois les « preuves » qui se révèlent erronées ou invérifiables.
Il est aisé de faire des prédictions, même du type de celles qui n’avantagent qu’une seule religion; mais si elles ne réalisent pas, il est évident que vous avez de sérieux problèmes. Certaines sources chrétiennes avancent que la raison pour laquelle les Juifs sont en exil est qu’ils n’ont pas accepté le Messie chrétien; elles prédisent que les Juifs resteront en exil jusqu’à ce qu’ils se convertissent. Cette prédiction – que les Juifs resteront en exil jusqu’à ce qu’ils acceptent le Messie chrétien – fait partie de la bonne catégorie; la logique est au moins respectée, étant donné qu’il s’agit d’une prédiction à laquelle personne d’autre ne prêterait foi. Un Hindou n’aurait aucune raison de s’attendre à ce que les Juifs restent en exil jusqu’à ce qu’ils acceptent le Messie chrétien; cela n’a aucune sens pour lui. Idem pour un Bouddhiste, un Musulman, un Shintoïste, un Taoïste, un Confucianiste ou un Athée; les Juifs n’y croient certainement pas. Cette prédiction, à laquelle personne d’autre ne croit, fait partie de la bonne catégorie.
Mais, depuis 1948 et la création de l’Etat d’Israël, cette prédiction a commencé à avoir du plomb dans l’aile. D’accord, en 1948 nous n’avions pas encore Jérusalem. Mais c’est chose faite depuis 1967 avec la conquête de Jérusalem lors de la Guerre des Six Jours; les choses sont ainsi devenues encore pires. Il y avait bien encore l’U.R.S.S. qui empêchait les Juifs de quitter le pays, offrant ainsi une position de dernier retranchement; mais même ce dernier rempart s’est effondré au cours des dernières années, avec la chute de l’Union Soviétique et l’immigration massive des Juifs russes en Israël. Les Juifs de Russie sont libres de partir; la prédiction ne s’est purement et simplement pas réalisée. Le fait qu’il y ait des Juifs refusant de quitter leurs luxueux appartements de Manhattan pour venir s’établir dans des résidences plus étroites à Tel Aviv ne peut pas décemment être considéré comme une punition. La situation ne correspond pas à ce que les textes chrétiens avaient prévu, c’est-à-dire que les Juifs seraient punis par l’exil pour ne pas avoir accepté le Messie chrétien; cela n’est simplement pas arrivé.
En plus, le bien-fondé de la preuve doit être vérifiable , ou alors les autres candidats sont libres de la rejeter. Par exemple, si l’Islam utilisait l’ascension miraculeuse au ciel de Mahomet comme « élément de preuve », les autres religions nieraient purement et simplement qu’une telle chose se soit passée. C’est pour cette raison que les nombreuses histoires de lévitation, de voyage à des vitesses surnaturelles, de révélations personnelles, etc, qu’on trouve dans bien des religions, sont inutiles du point de vue de leur force prouvante – elles ne sont pas reconnues comme vraies.